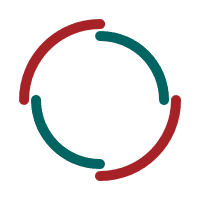Classification
- ClasseInsecta
- OrdreOdonata
- FamillePlatycnemididae
- GenrePlatycnemis
- Espèceacutipennis
- Nom scientifiquePlatycnemis acutipennis
Cartes, phénologie, nombre de données, etc...
Carte de l'espèce
Espèce rare en Bourgogne, l’Agrion orangé est essentiellement localisé à l’ouest de la Nièvre. C’est la coloration de l’abdomen des adultes qui lui a valu son nom vernaculaire.
Morphologie
Longueur du corps : 34-37 mm
Longueur des ailes postérieures : 18-19 mm
Les plactycnémidés se différencient des autres zygoptères par le dessin latéral du thorax (deux lignes noires épaisses continues) et par les tibias des pattes médianes et postérieures généralement élargis. Le mâle mature se distingue facilement de l’autre espèce du genre présente en Bourgogne, l’Agrion à larges pattes, par la coloration orangée soutenue de son abdomen. La seule espèce qui, à distance, pourrait prêter à confusion est l’Agrion nain dont une variante, la forme « aurantiaca » de la femelle présente une couleur identique de l’abdomen, mais son thorax est aussi orangé. Les yeux des adultes sont d’un bleu clair lumineux.
La détermination des femelles est beaucoup plus délicate. La coloration orangée est nettement plus terne que chez le mâle. L’abdomen est paré de deux traits sombres.
La différenciation des immatures (abdomen alors blanchâtre), avec les femelles d’Agrion à larges pattes n’est pas évidente. Il faut examiner attentivement les tibias médians et postérieurs qui ne sont pas dilatés chez la première espèce alors qu’ils le sont pour la seconde. Le second critère à détailler est la morphologie du prothorax vu de dessus, et plus particulièrement son bord postérieur en forme de V, terminé par une dent de chaque côté uniquement chez l’agrion orangé.
La distinction des larves et des exuvies des deux espèces est quasiment impossible.
Habitat
En Bourgogne, l’espèce ne semble fréquenter que les eaux dormantes des étangs, parfois forestiers mais présentant des secteurs ensoleillés. Dans d’autres régions, on la rencontre aussi, et souvent préférentiellement, dans les secteurs de rivières et ruisseaux à courant plus ou moins lents.
La présence d’une végétation aquatique immergée assez dense, ou de racines d’arbres sur les bordures, est nécessaire au développement larvaire. Les adultes ne s’éloignent guère de ces milieux, ils peuvent toutefois fréquenter les prairies riveraines ou les lisières forestières, par exemple.
Reproduction et cycle de développement
Le mâle, lorsqu’il est à la recherche d’une femelle, pratique une sorte de parade nuptiale avec un vol rectiligne particulier (vibré) en rasant l’eau. On peut alors observer une attitude d’intimidation à l’égard d’autres mâles : lors d’un vol tournant il recourbe l’extrémité de l’abdomen.
De suite après la fécondation qui a lieu au cours de la formation du « cœur copulatoire », la femelle en tandem avec le mâle (le plus souvent) insère ses œufs en lignes parallèles dans les plantes aquatiques immergées, tout près de la surface de l’eau.
L’éclosion des œufs est très rapide, il n’y a pas de diapause chez cette espèce.
Le développement larvaire nécessite deux années, mais parfois seulement 13 ou 14 mois. Comme pour les autres espèces du genre, on distingue 11 à 13 stades correspondant chacun à une mue.
Les émergences ont lieu dès la mi-mai et s’étalent sur une bonne partie de l’été. La phase de maturation est rapide, 2 ou 3 jours, et la durée de vie des imagos est réduite, en moyenne de 10 à 15 jours.
L’observation des adultes en Bourgogne s’étale de mi-mai à mi-août avec un pic en juin-juillet.
Régime alimentaire
La larve chasse à l’affût dans les herbiers où elle se cache. Selon le stade de développement, elle capture des micro-invertébrés, du zooplancton aux jeunes larves d’autres insectes aquatiques (diptères, éphémères,…).
Les imagos, posés sur un support, guettent les insectes volants qui passent à proximité: diptères principalement (moucherons, moustiques), mais aussi hyménoptères et lépidoptères ; ils les capturent en vol et se reposent sur le même support pour les consommer.
Relation avec l’homme
Même si globalement les biotopes de l’espèce ne semblent pas soumis à une trop forte pression humaine, hormis les risques de pollutions localement, l’Agrion orangé est considéré comme « quasi menacé » à l’échelon européen. Une régression des populations est constatée ces dernières années dans plusieurs régions de France, notamment en Auvergne et Rhône-Alpes. Il est classé vulnérable en Bourgogne sur la récente Liste Rouge régionale.
Réseau trophique
Comme pour les autres espèces de zygoptères, les œufs et les larves servent de nourriture à de nombreux poissons (Brochet, Carpe, Gardon,…) ainsi qu’à des amphibiens (grenouilles et tritons).
Le moment des émergences est toujours une étape délicate dans la vie des odonates en général ; de nombreux individus se prennent dans les toiles d’araignées diverses ou sont consommés par certains diptères (Asilides par exemple) et d’autres zygoptères, y compris des congénères.
De nombreuses espèces d’oiseaux sont potentiellement prédatrices de l’espèce, de l’Hirondelle à l’Aigrette et autres hérons.
Répartition géographique
La distribution mondiale de l’espèce est réduite uniquement à la péninsule ibérique et au deux tiers sud-ouest de la France. La Bourgogne se trouve en limite de cette aire de répartition et la faible population présente est localisée, pour l’essentiel à la bordure occidentale de la Nièvre, une seule observation du sud de l’Yonne, en Puisaye, ayant été enregistrée dans la « Bourgogne Base Fauna » en date du 31/12/2016.
Il faut aussi signaler que, comme c’est souvent le cas dans les marges d’une aire de répartition, les populations sont inconstantes d’une année à l’autre sur les différents sites de reproduction.