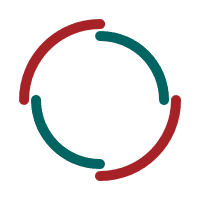Classification
- ClasseInsecta
- OrdreLepidoptera
- FamilleZygaenidae
- GenreRhagades
- Espècepruni
- Nom scientifiqueRhagades pruni
Cartes, phénologie, nombre de données, etc...
Carte de l'espèce
Morphologie
Envergure : 20-25 mm
Le Procris du Prunier ressemble aux autres « zygènes » turquoise, mais il présente une coloration caractéristique noir verdâtre à éclat métallique lorsqu’il est frais, gris sombre et sans refl et chez les sujets âgés. Les ailes sont très allongées et le corps est irisé de bleu-vert métallique. Le mâle est pourvu d’antennes bipectinées, épaisses, tandis que celles de la femelle, filiformes, se terminent en pointe. Le risque de confusion reste faible dans nos régions, mais on prendra garde à ne pas se laisser tromper par l’aspect de certains Adscita geryon fraîchement éclos.
Habitat
Le Procris du Prunier est une espèce thermophile, très discrète, pouvant néanmoins être aperçue en vol le matin, se tenant cachée au revers des feuilles le reste de la journée. Le Procris du Prunier fréquente les lisières ensoleillées et les friches anciennes, buissonneuses, souvent en fond de vallon, à proximité de milieux humides. Elle préfère nettement les sols marno-calcaires, sur lesquels sa chenille est tributaire du Prunellier (Prunus spinosa), mais elle présente également un autre écotype (ssp. callunae), localisé dans le Morvan, dont la larve pourrait se développer sur la Callune. Les mâles se tiennent au repos avec les ailes étroitement repliées en toit pentu. L’espèce ne fréquente pas les fleurs, il faut donc rester très attentif pour l’observer, ou rechercher au printemps sa chenille aux couleurs caractéristiques gris bleuté, orange et brun rougeâtre.
Reproduction
Espèce à une génération, elle présente une période de vol très brève, de la mi-juin à la mi-juillet.
Régime alimentaire
L’espèce ne fréquente pas les fleurs ; son mode d’alimentation reste inconnu.
Relation avec l’homme
Le Procris du Prunier est directement menacé par la fermeture des friches. Il se plaît dans les milieux dont le taux de recouvrement de l’embuissonnement atteint 50 %, le plus souvent en bas-de-versant.
Réseau trophique
Les papillons sont les proies de nombreux insectivores, ils peuvent être consommés par d’autres insectes et des oiseaux par exemple.
Répartition géographique
Espèce eurosibérienne à distribution très lacunaire, y compris en France, elle est très localisée sur les plateaux calcaires saônois (Vesoul, Gy, Champlitte) et dans la dépression marneuse sousvosgienne, elle reste peu connue dans le reste de la Franche-Comté. La répartition semble grandement sous-estimée. Il conviendrait de cibler la recherche sur les chenilles. En Bourgogne, l’espèce est inféodée aux terrains thermophiles de l’auréole calcaire jurassique (du Chablis au Tournugeois), et fait défaut sur les terrains cristallins et volcano-sédimentaires morvandiaux humides, au nord d’Autun. L’espèce est peu fréquente, voire très rare en Franche-Comté, et en régression apparente. Elle est plutôt localisée sur la Côte dijonnaise.