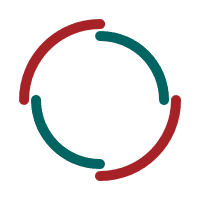Classification
- ClasseInsecta
- OrdreOdonata
- FamilleGomphidae
- GenreOphiogomphus
- Espècececilia
- Nom scientifiqueOphiogomphus cecilia
Cartes, phénologie, nombre de données, etc...
Carte de l'espèce
Espèce emblématique de la Loire et de l’Allier en Bourgogne, le Gomphe serpentin est la seule espèce du genre dans la famille des Gomphidés. L’adulte est d’approche difficile compte tenu de sa vivacité.
Morphologie
Longueur du corps : 50-60 mm
Longueur des ailes postérieures : 30-36 mm
Comme pour tous les gomphes, les yeux, verts chez cette espèce, sont nettement séparés et l’ensemble du corps présente une coloration de fond jaune-vert avec des motifs noirs régulièrement répartis. Chez l’adulte le thorax est d’un vert intense très lumineux marqué de fines lignes noires.
Pour une identification certaine, notamment sur photo, il est nécessaire de pouvoir examiner avec attention, chez le mâle, les appendices anaux épaissis de couleur jaune, et chez la femelle, la présence de deux proéminences (« petites cornes ») sur l’occiput.
Sa larve au dernier stade et son exuvie sont très semblables à celles du Gomphe à pinces avec lequel il cohabite.
Habitat
Cette espèce vit principalement dans les eaux courantes des grands cours d’eau à fond sablonneux ou graveleux.
La présence de secteurs plus calmes (bras secondaires, boires), de zones peu profondes, de ripisylves alternant avec des rives dégagées, constituent autant de facteurs favorables.
La vie larvaire se passe dans les sédiments, non colmatés, de sable ou de graviers de petit calibre.
Des récoltes d’exuvies sur les bords de Loire ont montré que le Gomphe serpentin cohabite avec d’autres espèces de la même famille : Gomphe vulgaire, Gomphe similaire, Gomphe à pattes jaune, Gomphe à pinces.
Des inventaires menés sur la Réserve du Val de Loire ont révélé que c’est le gomphidé le plus abondant, aussi bien sur le chenal principal que sur les bras secondaires.
A l’instar des autres espèces de la famille des gomphidés, l’adulte aime à se poser sur une pierre ou un embâcle émergent de l’eau et sur la végétation rivulaire si elle est bien ensoleillée, mais il est aussi très prompt à s’envoler d’un vol rapide à l’approche d’un intrus.
Reproduction et cycle de développement
C’est au cours de l’été (dès mi-juin), que la femelle pond seule (sans être accompagnée du mâle) en effleurant la surface de l’eau avec l’extrémité de l’abdomen, libérant les œufs dans les secteurs de rivière où la lame d’eau est plutôt faible (30-50 cm) et le fond sablonneux. Ces œufs enveloppés dans une couche de mucus vont se coller rapidement au substrat, évitant ainsi d’être entrainés par le courant.
L’éclosion a lieu rapidement, sauf si la température de l’eau est inférieure à 15°, auquel cas elle est différée de quelques mois (jusqu’au cœur de l’hiver).
La phase larvaire dure de 2 à 4 ans. On distingue 14 ou 15 stades correspondant chacun à une mue.
La période d’émergence se superpose remarquablement à celle du Gomphe à pattes jaunes qui fréquente les mêmes milieux, soit essentiellement de fin mai à fin juillet, mais aussi parfois en août et exceptionnellement jusqu’à début septembre.
Durant cette période on découvre les exuvies sur la rive, soit à même le substrat ou sur des embâcles, soit dans la végétation riveraine, parfois à plus d’un mètre cinquante au-dessus de l’eau. La présence de chevelu racinaire (arbre ou arbuste) sur une rive érodée est souvent propice à la récolte de nombreuses exuvies.
Après la phase de maturation qui peut durer deux semaines, l’imago s’éloigne de son biotope de naissance, des observations à plus de 10 km de tout site potentiel de ponte ne sont pas rares.
De retour sur les sites de reproduction, les adultes sont présents jusqu’à mi-octobre en Bourgogne, en fonction de la douceur automnale.
Hormis lors de la découverte d’une émergence ou d’un accouplement, l’observation des femelles est beaucoup plus rare que celle du mâle, tant elles sont discrètes sur les lieux de reproduction.
Régime alimentaire
La larve se nourrit de proies plus ou moins petites (selon le stade de développement) qu’elle chasse à l’affut à moitié enfouie dans les sédiments où elle vit : rotifères, insectes aquatiques au stade larvaire (diptères, éphémères, névroptères…), crustacés (gammares, aselles), voire jeunes alevins.
Les adultes chassent en vol différentes sortes d’insectes volants de taille variable : diptères (majoritairement), éphémères, trichoptères, lépidoptères, voire autres espèces d’odonates plus petites (zygoptères). Ces proies sont le plus souvent dévorées en vol.
Relation avec l’homme
Compte tenu du fait qu’il est très exigeant sur la structure et la qualité des habitats qui constituent son biotope larvaire, ce gomphidé est très vulnérable.
Le maintien de la dynamique fluviale des grands fleuves tels que la Loire est primordial pour sa conservation. Des enrochements intempestifs ou des rectifications des berges pourraient constituer une atteinte aux populations concernées.
Figurant aux annexes II et IV de la Directive Habitats à l’échelon européen, le Gomphe serpentin bénéficie d’une protection nationale depuis 1993. Il figure dans la catégorie « vulnérable » sur la récente Liste Rouge des espèces menacées en Bourgogne. Il est aussi prioritaire dans le Plan Régional d’Action développé en faveur des Odonates. En outre, cette espèce est considérée comme déterminante pour le classement des ZNIEFF dans notre région.
Réseau trophique
Différentes espèces de poissons (perche, sandre, goujon,…) consomment les œufs qui viennent d’être pondus ainsi que des larves. Plusieurs espèces d’oiseaux tels que Martin-pêcheur, Bergeronnette des ruisseaux, peuvent se nourrir des larves aux derniers stades, mais aussi des individus émergents. De même, quelques arthropodes (araignées, fourmis) sont potentiellement des prédateurs de ce gomphe lors des émergences.
Malgré leur vivacité, les imagos sont parfois la proie du Guêpier d’Europe et du Faucon hobereau.
Répartition géographique
On trouve cette espèce de l’Europe occidentale et septentrionale jusqu’à l’Oural, mais elle se raréfie en Europe centrale.
En France, sa localisation est limitée, pour l’essentiel de la population, à la vallée de la Loire où elle atteint des densités encore relativement importantes. Un autre noyau subsiste en Alsace.
En Bourgogne, outre les vals de Loire et d’Allier où sa présence est régulière, l’espèce a été observée ponctuellement dans le Morvan (58) et au bord du Doubs (71).